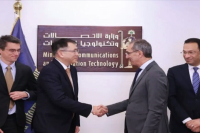Gestion Publique (510)
Les collaborations internationales dans le numérique sont essentielles pour favoriser l’innovation et partager les savoir-faire. En unissant leurs forces, les pays stimulent le développement technologique, créent des opportunités économiques et renforcent leur compétitivité sur la scène globale.
La Tunisie et l’Inde souhaitent collaborer davantage dans le domaine technologique. Cette ambition a été au centre des discussions de la cinquième réunion du comité mixte tuniso-indien pour la coopération scientifique et technologique, tenue le mercredi 8 janvier au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, à Tunis.
Lors de cette rencontre, les deux pays ont convenu de lancer un appel à projets visant à financer des initiatives communes axées sur des thématiques prioritaires telles que l’innovation environnementale, la santé électronique (e-Health) et la technologie géospatiale. Ces projets intégreront des acteurs économiques et sociaux, et seront accompagnés d’ateliers conjoints pour encourager les échanges et la collaboration entre les chercheurs tunisiens et indiens.
Cette initiative s’inscrit dans la continuité de l’accord de coopération scientifique signé en 1995, ainsi que du partenariat établi en 2020 pour la création d’un Centre tuniso-indien d’innovation dans le domaine des TIC.
La collaboration entre les deux pays présente des avantages mutuels. L’Inde, reconnue pour son expertise dans le numérique et les technologies géospatiales, pourrait offrir à la Tunisie une occasion précieuse de tirer parti de son savoir-faire tout en renforçant les capacités locales en matière de recherche et d’innovation. Pour l’Inde, ce partenariat stratégique représente une opportunité d’élargir ses liens avec l’Afrique du Nord et d’accroître son influence dans des domaines technologiques clés, notamment les centres d’innovation et l’usage des drones.
Par ailleurs, la Tunisie figure parmi les pays africains les plus dynamiques en matière de développement numérique. Selon le rapport « The ICT Development Index 2024 » de l’Union internationale des télécommunications (UIT), le pays occupe la 8ᵉ place en Afrique, avec un score de 77,2 sur 100, témoignant de ses avancées significatives dans le secteur des TIC.
Samira Njoya
Edité par Sèna D. B. de Sodji
Les deux royaumes ont déjà signé un protocole d’accord en décembre. Ils ont convenu de soutenir la recherche, l’innovation et l’adoption de technologies avancées dans le domaine de l’e-gouvernement, tout en échangeant les meilleures pratiques et en renforçant les capacités spécialisées.
Le Maroc veut renforcer sa coopération avec l’Arabie saoudite notamment dans les domaines de l’intelligence artificielle (IA), de la transformation numérique et de la réforme de l’administration. La question a été abordée la semaine dernière lors d’une réunion de travail entre Amal El Fallah Seghrouchni (photo, à gauche), ministre marocaine de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, et Sami bin Abdullah bin Othman Al-Saleh (photo, à droite), ambassadeur de l’Arabie saoudite au Maroc.
Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts de coopération internationale du gouvernement marocain pour la mise en œuvre de sa nouvelle stratégie de transformation numérique, « Digital Maroc 2030 », lancée officiellement en septembre. Un protocole d’accord a déjà été signé en décembre avec l’Arabie saoudite pour renforcer la coopération en ce qui concerne l’e-gouvernement. Le royaume chérifien s’était également rapproché du Portugal et de l’Estonie, ce dernier étant considéré comme l’un des champions mondiaux en matière de transformation numérique.
L’Arabie saoudite se classe sixième mondiale selon l’indice de développement de l’e-gouvernement du département des affaires économiques et sociales des Nations unies (DAES). Le royaume affiche un score de 0,9602 sur 1. Pour les sous-indices des services en ligne et de l’infrastructure télécoms, le pays affiche des scores respectifs de 0,9900 et 0,9841. De plus, l’Union internationale des télécommunications (UIT) classe le pays parmi les exemples à suivre en matière de cybersécurité, ayant validé tous les cinq piliers composant l’indice de cybersécurité.
Le Maroc occupe la 4e place en Afrique et la 90e au niveau mondial dans le domaine de l’e-gouvernement, avec un score de 0,6841 sur 1. Le royaume dépasse les moyennes de l’Afrique du Nord (0,5776), de l’Afrique (0,4247) et même du monde (0,6382). Cependant, des efforts restent nécessaires, notamment pour renforcer le développement du capital humain et améliorer les services en ligne. En matière de cybersécurité, le Maroc se distingue également comme un modèle à suivre. Néanmoins, il doit intensifier ses actions en matière de renforcement des mesures et de développement des capacités.
Les efforts de coopération du gouvernement marocain pourraient accélérer la réalisation de l’ambition des autorités de positionner le royaume chérifien comme un hub numérique, contribuant ainsi à accélérer le développement social et économique d’ici 2030. Le gouvernement vise une contribution du secteur numérique estimée à 100 milliards de dirhams marocains (10 milliards USD) à cette échéance. Cependant, il est important de souligner que ces discussions en sont encore à un stade préliminaire. Même pour le protocole d’accord signé en décembre 2024, aucun calendrier précis n’a encore été communiqué concernant sa mise en œuvre.
Isaac K. Kassouwi
Edité par Sèna D. B. de Sodji
Lire aussi:
Maroc : la DGSN lance une plateforme numérique de services de police
Le gouvernement gambien veut accélérer la transformation numérique du pays. L’exécutif s’est déjà rapproché de la société technologique émiratie Presight en mai 2024.
Le ministère des Communications et de l’Économie numérique de Gambie s’est associé à la Kalp Foundation, une organisation à but non lucratif qui se consacre à la création d’infrastructures publiques numériques (DPI) basées sur la blockchain. Cette collaboration aboutira à une plateforme décentralisée dénommée « Gambia One », visant à sécuriser les échanges de données, rationaliser les opérations gouvernementales et numériser les services critiques.
« Ensemble, nous exploiterons la puissance du DPI basé sur la blockchain pour fournir des solutions innovantes et centrées sur les citoyens qui s’alignent sur les normes mondiales de confiance, de transparence et de responsabilité », a déclaré Lamin Jabbi, ministre gambien des Communications et de l’Économie numérique. La collaboration inclut également des initiatives de renforcement des capacités destinées aux dirigeants gouvernementaux, ainsi que des programmes de formation axés sur l’écosystème blockchain et les technologies connexes pour les jeunes Gambiens.
Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’ambition du gouvernement gambien « d’exploiter la technologie, les solutions et services numériques pour garantir l’inclusion numérique en connectant les non-connectés et les sous-connectés, créer des emplois et développer l’économie ». C’est dans ce cadre que la Gambie s’est rapprochée de la société technologique émiratie Presight en mai 2024. En 2023, le pays avait déjà rejoint l’Alliance Smart Africa, qui promeut l’utilisation des TIC pour accélérer le développement économique et social en Afrique.
Pour le moment, la Gambie se classe 164e sur 193 pays selon l’indice de développement de l’e-gouvernement 2024 mesuré par le Département des affaires sociales et économiques des Nations unies (DAES). Le pays affiche un score de 0,2552 sur 1, bien en dessous des moyennes en Afrique de l’Ouest (0,3957), en Afrique (0,4247) et dans le monde (0,6382).
Il est important de souligner que le calendrier de mise en service de la plateforme reste inconnu à ce jour, tout comme les détails précis sur la nature de l’accord conclu entre les deux parties. Ce qui est certain, c’est que l’adoption des services dépendra de l’accès de la population à Internet et à des appareils compatibles. Selon DataReportal, la Gambie comptait 1,5 million d’abonnés à Internet au début de l’année 2024, soit un taux de pénétration de 54,2 %.
Isaac K. Kassouwi
Edité par Sèna D. B. de Sodji
Lire aussi:
La Gambie veut développer un cadre réglementaire contre le harcèlement en ligne
La Gambie œuvre pour la numérisation de la gestion des écoles
Le gouvernement congolais mise sur la coopération internationale pour accélérer sa transformation numérique. En novembre 2024, un protocole d’accord avait déjà été signé avec la Pologne pour développer les infrastructures numériques.
La République démocratique du Congo (RDC) et le Qatar envisagent de renforcer leur coopération bilatérale dans le secteur des technologies de l’information et de la communication (TIC), entre autres. La question a été abordée lors d’une rencontre entre le président congolais, Félix Tshisekedi (photo, à gauche), et l’émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani (photo, à droite), dimanche 5 janvier, dans le cadre d’une visite officielle dans le pays du Moyen-Orient.
Ce rapprochement intervient dans un contexte où le gouvernement congolais multiplie les efforts dans le cadre de sa vision de « faire du Numérique congolais un levier d’intégration, de bonne gouvernance, de croissance économique et de progrès social ». En 2024, le pays se classait 41e sur 47 pays africains en matière de développement des TIC selon l’Union internationale des télécommunications (UIT) avec un score de 31 sur 100. De plus, les sources officielles indiquent que le taux de pénétration de l’Internet dans le pays est de 30%, contre environ 50% pour la téléphonie mobile.
De plus, le Département des affaires économiques et sociales des Nations unies (DAES) classe la RDC 175e sur 193 au plan mondial en matière de développement de l’e-gouvernement en 2024 avec un score de 0,2715 sur 1. Le pays est en dessous des scores moyens en Afrique centrale (0,3354), en Afrique (0,4247) et dans le monde (0,6382).
En ce qui concerne la cybersécurité, l’UIT classe la RDC dans la catégorie Tier 3 regroupant des pays qui « démontrent un engagement de base en matière de cybersécurité à travers des actions pilotées par le gouvernement, qui incluent l’évaluation, l’établissement ou la mise en œuvre de certaines mesures généralement acceptées en cybersécurité ». Le pays doit notamment faire des efforts dans les domaines des mesures techniques, le développement des capacités et la coopération.
De son côté, le Qatar affiche un score de développement des TIC de 97,8 sur 100. En matière de développement de l’e-gouvernement, le pays affiche un score de 0,8244. Il fait également partie des exemples à suivre dans le monde en ce qui concerne la cybersécurité selon l’UIT.
Le renforcement de la collaboration avec le Qatar pourrait aider le gouvernement congolais à développer son secteur des TIC et accélérer ses ambitions de transformation numérique. Cependant, les détails précis de ce partenariat, notamment les axes d’intervention et le calendrier de mise en œuvre, restent à définir. Par ailleurs, aucun accord formel n’a encore été signé ou officiellement annoncé entre les deux parties.
Isaac K. Kassouwi
Edité par Sèna D. B. de Sodji
Lire aussi:
La RDC sollicite l’aide de la France pour numériser sa bibliothèque nationale
Internet par satellite : la RDC signe un protocole d'accord avec Monacosat
Les autorités mauritaniennes poursuivent la mise en œuvre de la stratégie de transformation numérique nationale. L’objectif est de faire du numérique un véritable levier de développement socio-économique du pays.
Le gouvernement mauritanien a annoncé la semaine dernière le lancement du visa électronique (e-visa). Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Mauritaniens de l’extérieur a déclaré qu’à partir du 5 janvier, « tout passager soumis à l’obligation de visa doit obligatoirement obtenir son visa électronique avant son embarquement pour se rendre en Mauritanie ». Les demandes devront être effectuées via le site officiel de l’Agence nationale du registre des populations et des titres sécurisés (ANRPTS).
Cette mesure est valable pour les ressortissants de tous les pays du monde à l’exception de ceux avec lesquels la Mauritanie a des accords de suppression réciproque de visa. Selon le ministère, ils sont au nombre de 18, dont dix en Afrique : le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, la Libye, le Mali, le Sénégal, la Gambie, le Niger, la Côte d’Ivoire et le Tchad. Pour certains pays, dont le Maroc, l’exemption de visa concerne uniquement les passeports diplomatiques et de service.
L’initiative peut s’inscrire dans le cadre de la mise en œuvre de « l’Agenda national de transformation numérique 2022-2025 ». A travers cette feuille de route, l’exécutif ambitionne de faire du numérique un véritable levier de développement socio-économique du pays.
L’e-visa pourrait faciliter l’entrée d’étrangers en Mauritanie. Cela devrait soutenir le développement du tourisme que le gouvernement cherche à relancer conformément à la stratégie nationale du tourisme 2018-2030. Selon un rapport du Fonds monétaire international (FMI) publié en juin 2024, le PIB référentiel du secteur touristique mauritanien se chiffrerait à 1,8 milliard d’ouguiyas (45,05 millions $) en 2021 et atteindrait 2,2 milliards d’ouguiyas en 2025.
L’institution de Bretton Woods ajoute que « le secteur dispose d’un fort potentiel pouvant être mis à profit, pourvu qu’une offre adaptée aux exigences des touristes nationaux et internationaux soit développée et que la sécurité territoriale soit renforcée ».
Isaac K. Kassouwi
Edité par Sèna D. B. de Sodji
Lire aussi:
La Mauritanie lance une plateforme pour les marchés publics
La Mauritanie se dote d'une stratégie d’e-Santé pour un accès équitable aux soins
Protection des données personnelles : l’Algérie et la Mauritanie s’associent
L’année dernière, le Mozambique a annoncé son intention d’introduire une fiscalité sur l’économie numérique à partir de 2024. Aujourd’hui, le pays cible particulièrement les entreprises numériques étrangères opérant dans le secteur du tourisme.
L’Autorité fiscale mozambicaine (AT) a récemment élaboré un projet de loi visant à formaliser la taxation des transactions en ligne dans le secteur du tourisme. À travers cette initiative, qui cible des plateformes comme Booking, Tripadvisor et Hotels.com, l’organisme gouvernemental veut réguler l’économie numérique et augmenter les recettes fiscales du pays.
Actuellement, ces plateformes prélèvent des commissions sur les réservations réalisées pour des établissements touristiques au Mozambique sans contribuer au système fiscal national. Le projet de loi, qui sera soumis lors de la prochaine session législative, vise à combler cette lacune en imposant ces entreprises sur les revenus générés dans le pays.
Amorim Ambasse, directeur de l’Unité de taxation de l’économie numérique au sein de l’autorité fiscale mozambicaine (AT), explique que, bien que ces plateformes n’aient pas de présence physique au Mozambique, elles génèrent des revenus considérables qui devraient « être imposables, car ils proviennent d’activités économiques exercées à l’intérieur des frontières du Mozambique ».
Cette démarche intervient dans un contexte de forte croissance du secteur touristique mozambicain. En 2023, les revenus du tourisme ont atteint 221,2 millions de dollars, enregistrant une hausse de 10,4 % par rapport à 2022, selon Eldevina Materula, ministre de la Culture et du Tourisme. Le nombre d’arrivées internationales a également progressé, dépassant 1,1 million de visiteurs en 2023, soit une augmentation de 31 % par rapport à l’année précédente.
Le projet suit une tendance nationale visant à réglementer et taxer l’économie numérique. En s’attaquant aux plateformes numériques étrangères, le gouvernement espère non seulement accroître les recettes fiscales, mais aussi créer des conditions équitables pour les entreprises locales et promouvoir une concurrence saine.
Si cette mesure est adoptée, elle pourrait accroître l’impact du numérique sur la croissance économique du Mozambique. Elle permettrait ainsi au pays de contribuer aux 712 milliards de dollars que l’économie numérique pourrait générer en Afrique d’ici 2050, selon la Société financière internationale et Google.
Melchior Koba
Edité par Sèna D. B. de Sodji
Lire aussi:
Vers une interconnexion du Burundi et de la Zambie par fibre optique
Le numérique s’impose comme un levier essentiel pour moderniser les services publics et renforcer leur accessibilité. En Afrique, cette révolution technologique ouvre de nouvelles perspectives pour rapprocher les administrations des citoyens et optimiser leur expérience.
La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) du Maroc a annoncé le lancement, le vendredi 20 décembre, de sa plateforme numérique baptisée E-Police. Ce portail interactif vise à simplifier l’accès des citoyens aux services administratifs policiers, marquant une étape clé dans la modernisation des institutions publiques du royaume.
Doté de technologies avancées d’e-administration, le portail intègre des fonctionnalités telles que la vérification d’identité à distance, le traitement rapide des demandes et une protection renforcée des données personnelles. Il s’inscrit dans une dynamique de digitalisation des services publics pour améliorer l’expérience utilisateur et répondre aux standards internationaux en matière de sécurité des données.
Le premier service numérique disponible sur E-Police est la fiche anthropométrique, désormais accessible en ligne via les systèmes de « Tiers de confiance » et « Identité numérique » conçus par la DGSN. Ce service permet aux citoyens d’effectuer leur demande à distance, réduisant ainsi les délais et simplifiant les démarches administratives.
En plus de ce service, E-Police propose déjà des options comme la prise de rendez-vous pour la carte d’identité nationale électronique et l’inscription aux concours de police. À terme, la plateforme intégrera davantage de services tels que le certificat de résidence ou le renouvellement de la carte nationale d’identité électronique, créant un guichet unique pour les démarches administratives.
Ce projet s’inscrit dans la vision « Digital Maroc 2030 », qui vise à positionner le Royaume parmi les leaders régionaux en matière de transformation numérique. Avec plus de 600 services déjà digitalisés, le Maroc ambitionne d’améliorer son classement dans l’indice des services en ligne des Nations unies, actuellement à la 90e place, et de répondre aux attentes croissantes des citoyens en termes d’efficacité et d’accessibilité.
En facilitant l’accès aux services publics, en accélérant les délais de traitement et en renforçant la transparence, E-Police symbolise un pas décisif vers une administration moderne, connectée et orientée vers l’amélioration de la qualité de vie des citoyens marocains.
Samira Njoya
Edité par Sèna D. B. de Sodji
Le gouvernement égyptien mise sur la coopération pour atteindre ses objectifs de transformation numérique. Par exemple, un accord a été signé en septembre pour renforcer les investissements chinois dans le secteur des TIC national.
L’Égypte explore des opportunités pour renforcer sa coopération avec la Banque mondiale dans le domaine du numérique. Amr Talaat, ministre égyptien des Communications et des Technologies de l’information, a rencontré et discuté avec Sangboo Kim, vice-président de la Banque mondiale en charge de la transformation numérique, en visite dans le pays du mardi 17 au jeudi 19 décembre.
Les discussions ont notamment porté sur la transformation numérique, le développement des infrastructures technologiques, la sensibilisation au numérique et le renforcement des compétences numériques. M. Kim a également souligné l’importance de partager l’expérience de l’Égypte en matière de transformation numérique avec d’autres nations et d’exploiter l’expertise du pays pour soutenir les autres dans la réalisation de leurs objectifs numériques.
Ce rapprochement peut s’inscrire dans le cadre des efforts visant à accélérer la mise en œuvre de la stratégie nationale de transformation numérique : « Digital Egypt 2030 ». Le gouvernement égyptien cherche à développer le secteur des TIC et à moderniser l’infrastructure télécoms nationale afin de positionner le numérique comme moteur du développement socio-économique du pays.
Actuellement, l’Égypte est classée sixième en Afrique et 95e dans le monde selon l’indice de développement de l’e-gouvernement (EGDI) 2024, mesuré par le Département des affaires économiques et sociales des Nations unies (DAES). Le pays affiche un score de 0,6699 sur 1, se plaçant au-dessus de la moyenne en Afrique du Nord (0,5776), en Afrique (0,4247) et dans le monde (0,6382). En matière de développement des TIC, l’Union internationale des télécommunications (UIT) classe l’Égypte à la 9e position en Afrique sur 47 pays, avec un score de 76,8 sur 100.
Bien qu’un partenariat avec la Banque mondiale puisse contribuer à l’atteinte des objectifs de transformation numérique de l’Égypte, les modalités de cette collaboration restent à préciser. À ce stade, aucun accord n’a été signé ni même annoncé entre les deux parties. Il convient donc d’attendre les développements à venir avant d’émettre des conclusions sur les perspectives de cette coopération.
Isaac K. Kassouwi
Edité par Sèna D. B. de Sodji
Lire aussi:
L’Egypte veut renforcer les investissements chinois dans le secteur des TIC
Dans le cadre de ses ambitions de transformation numérique, le gouvernement kényan veut s’appuyer sur les TIC pour améliorer l’efficacité des services publics. Le gouvernement a annoncé vouloir numériser 80 % des services publics.
Le gouvernement kényan envisage de numériser les opérations de la police. L’initiative fait partie d’un programme de modernisation des services de la Police nationale qui prévoit un investissement de 28 milliards de shillings (216,6 millions $), au cours des deux prochaines années, afin de renforcer la sécurité nationale. Elle a été révélée la semaine dernière par le président William Ruto, lors du lancement des plans stratégiques de la Police nationale et du Département d’État des services correctionnels pour la période 2023-2027.
« Nous avons besoin d’un service de police moderne et la technologie en est la clé. Nous devons veiller à numériser les opérations, y compris le fameux OB [Occurrence Book/journal de bord, Ndlr] », a déclaré le président. « Dans le paysage numérique en constante évolution d’aujourd’hui, de nombreuses infractions et menaces à la sécurité sont facilitées par les technologies numériques. La capacité à détecter, perturber, collecter des données et enquêter sur ces menaces dépend de notre aptitude à évoluer efficacement dans un environnement technologique avancé », a-t-il ajouté.
Cette initiative s’inscrit dans le cadre plus large du programme d’accélération de l’économie numérique du Kenya. À son accession au pouvoir en septembre 2022, le président William Ruto a affiché son ambition de mettre la technologie numérique au service du développement socio-économique d’ici 2027. Outre le renforcement de l’infrastructure télécoms et l’amélioration de l’accès Internet, l’exécutif s’est fixé pour objectif de numériser au moins 80 % des services publics et de les rendre disponibles dans un guichet unique, la plateforme E-Citizen.
Actuellement, le Kenya se classe au 109e rang mondial selon l’indice de développement de l’e-gouvernement 2024 du Département des affaires économiques et sociales des Nations unies (DAES). Le pays affiche un score de 0,6314 sur 1. Il est au-dessus de la moyenne en Afrique de l’Est (0,3903) et en Afrique (0,4257), mais en dessous de la moyenne mondiale (0,6382). Pour le sous-indice des services en ligne, le pays affiche un score de 0,7770 sur 1.
Rappelons que l’économie numérique du Kenya devrait générer une contribution significative de 662 milliards de shillings au produit intérieur brut (PIB) du Kenya d’ici 2028, selon l’Association mondiale des opérateurs de téléphonie (GSMA).
Isaac K. Kassouwi
Edité par Sèna D. B. de Sodji
Lire aussi:
Kenya : plus de 5 milliards $ de PIB numérique d'ici 2028 (GSMA)
L’ère numérique redéfinit les standards de fonctionnement des administrations publiques. Face à ces évolutions, les pays investissent dans des technologies avancées pour optimiser leurs services et renforcer leur attractivité économique.
La douane tunisienne a présenté, le jeudi 12 décembre lors d’un colloque national, son projet stratégique de modernisation : le « Nouveau système d’information douanier » (SINDA2). Prévu pour une mise en œuvre progressive dès 2025, ce système vise à transformer les procédures douanières en y intégrant des technologies avancées et en promouvant un environnement sans papier.
« Avec SINDA2, nous mettons en place un système qui simplifie les processus, renforce la compétitivité économique et instaure une gestion douanière plus transparente et efficace. Ce projet représente une étape clé dans notre engagement pour une transformation numérique durable », a affirmé Abdelkrim Abidi, directeur général de l’École nationale des douanes, lors de son intervention.
Conçu pour couvrir toutes les procédures douanières, SINDA2 repose sur des technologies avancées qui favorisent une gestion collaborative entre la douane et ses partenaires externes. Parmi ses objectifs clés figurent la numérisation complète des documents, la mise en œuvre d’une politique de gestion des risques et la promotion d’un environnement sans papier. L’interopérabilité avec les systèmes d’information d’organismes tiers constitue également un atout central du projet, renforçant la coordination interinstitutionnelle et améliorant la traçabilité des opérations.
L’initiative intervient dans un contexte où la Tunisie se distingue par sa performance en matière d’administration électronique, notamment grâce à des projets antérieurs de numérisation tels que TUNEPS, le système national de gestion en ligne des achats publics. Selon le rapport « E-Government Survey 2024: Accelerating Digital Transformation for Sustainable Development » du Département des affaires économiques et sociales des Nations unies (DAES), le pays occupe la première place en Afrique du Nord et la troisième au niveau continental en matière de développement de l'administration en ligne avec un indice de 0,6935 sur 1.
À travers des initiatives comme SINDA2, la Tunisie confirme sa volonté de devenir un modèle régional en matière de transformation numérique et de gouvernance moderne.
Samira Njoya
Edité par Sèna D. B. de Sodji
Lire aussi:
LaTunisieveutrenforcersonpartenariatavec la Chine dans le numérique
More...
De nombreux pays africains veulent développer les TIC et les mettre au service de leur développement socioéconomique. Ils misent notamment sur la coopération internationale pour atteindre leurs objectifs.
L’Algérie explore des opportunités de partenariat bilatéral avec des pays africains pour le développement des technologies de l’information et de la communication (TIC). Sid Ali Zerrouki (photo, à droite), ministre de la Poste et des Télécommunications, a rencontré séparément ses homologues de la Tunisie, de la Mauritanie, des Comores et du Congo. C’était en marge du sommet ministériel de la troisième édition de la Conférence africaine des start-up, qui s’est tenue en Algérie du jeudi 5 au samedi 7 décembre.
Selon un communiqué du ministère algérien de la Poste et des Télécommunications, les discussions ont porté sur les moyens de renforcer la coopération et l’échange d’expertises dans plusieurs domaines d’intérêt commun. Il s’agit notamment des infrastructures de télécommunications, de la régulation des communications électroniques, la formation, les centres de données, le développement des TIC, ainsi que le soutien à l’innovation technologique et à l’entrepreneuriat.
Ce rapprochement intervient alors que la plupart des pays africains ont placé la transformation numérique au cœur de leurs stratégies de développement socioéconomique respectives. Cela passe par le développement des infrastructures de télécommunications et des TIC. L’Algérie se classe 6e en Afrique sur 47 pays étudiés en matière de développement des TIC, selon l’Union internationale des télécommunications avec un score de 80,9 sur 100. La Tunisie est 8e avec 77,2/100. La Mauritanie est 21e avec 55,5/100. Les Comores sont 25e avec 46,5/100. Le Congo occupe la 42e place avec 30,7 sur 100.
Pour rappel, une étude conjointe de la Société financière internationale (SFI) et de Google prévoit que l’économie numérique en Afrique atteindra une valeur d’au moins 712 milliards de dollars d’ici 2050, soit environ 8,5 % du PIB continental.
Isaac K. Kassouwi
Edité par Sèna D. B. de Sodji
Lire aussi:
L’Algérie lance son premier système d’exploitation basé sur Linux
Le pays d’Afrique du Nord cherche à accélérer sa transformation numérique, dont il a fait un pilier du développement socioéconomique. Il a prévu d’investir environ 25,8 millions $ dans les projets numériques au titre de l’exercice financier 2025.
Dans le cadre de sa stratégie de transformation numérique, la Tunisie cherche à intensifier sa coopération avec la Chine. Le 5 décembre, Sofiene Hemissi (photo, à droite), ministre tunisien des Technologies de la communication, a rencontré Wang Song (photo, à gauche), vice-ministre chinois de l’Administration du cyberespace, lors d’une visite de deux jours en Tunisie.
Les discussions ont notamment porté sur des enjeux liés au développement des infrastructures de télécommunications et à l’intelligence artificielle, selon la presse locale. Les deux parties ont également fait le point sur l’état des programmes de coopération bilatérale dans le domaine des technologies de l’information et de la communication, tout en explorant de nouvelles pistes de collaboration dans divers secteurs numériques.
Cette rencontre intervient dans un contexte où la Tunisie occupe la première place en Afrique du Nord et la troisième au niveau continental en matière d’administration électronique, d’après le rapport « E-Government Survey 2024: Accelerating Digital Transformation for Sustainable Development » du Département des affaires économiques et sociales des Nations unies (DAES). Le pays affiche un indice de 0,6935 sur 1, supérieur à la moyenne africaine de 0,4247, mais inférieur à la moyenne mondiale qui est de 0,6382. En matière de développement des TIC, le pays est classé 8e en Afrique sur 47 pays par l’Union internationale des télécommunications (UIT) avec un score de 77,2 sur 100.
En matière de cybersécurité, la Tunisie est classée dans la catégorie Tier 3, regroupant « des pays ayant obtenu un score global d’au moins 55/100, démontrant un engagement de base en matière de cybersécurité à travers des actions initiées par le gouvernement ». Le pays est appelé à faire davantage d’efforts en ce qui concerne les mesures organisationnelles, le développement des capacités et la coopération.
La Chine, de son côté, est classée 35e mondiale en matière de développement de l’e-gouvernement avec un score EGDI de 0,8718. Pour le développement des TIC, l’UIT lui attribue un score de 85,8 sur 100. En ce qui concerne la cybersécurité, le pays est classé dans la catégorie Tier 2, regroupant « les pays ayant obtenu un score global d’au moins 85/100, en témoignant d’un engagement fort en matière de cybersécurité grâce à des actions coordonnées et pilotées par le gouvernement ».
Un renforcement de la collaboration avec la Chine dans le secteur du numérique pourrait accélérer la transformation numérique de la Tunisie, dont le gouvernement a fait un pilier du développement socioéconomique. Il faut toutefois rappeler qu’aucun nouvel accord n’a encore été annoncé ou signé entre les deux parties.
Isaac K. Kassouwi
Edité par Sèna D. B. de Sodji
Lire aussi:
La Tunisie peaufine sa stratégie de transformation numérique et d’IA
De nombreux pays s'efforcent aujourd'hui de moderniser leurs systèmes administratifs pour mieux répondre aux défis de la gestion des données et de l'identité. Ces efforts reposent sur l’adoption des technologies numériques pour renforcer l’efficacité et l’inclusion.
Le Cameroun s'engage dans une transformation majeure de son système d'état civil, avec un projet de loi récemment débattu à l'Assemblée nationale. Cette réforme ambitieuse vise à moderniser une législation de 2011 devenue inadaptée et à aligner le pays sur les normes numériques internationales. L’objectif est de créer un système plus efficace, inclusif et sécurisé pour gérer les données essentielles des citoyens.
Selon le quotidien public Cameroon Tribune, ce texte propose l’adoption des technologies numériques pour l’enregistrement des faits d’état civil, y compris les actes de naissance, de mariage et de décès. Une innovation clé est l’introduction d’un numéro d’identification personnel unique, attribué dès la naissance. Ce code à chiffres permettra aux citoyens d’accéder plus facilement à divers services administratifs liés à des domaines tels que le travail, la santé et l’éducation. Par ailleurs, la réforme prévoit l’allongement du délai de déclaration des naissances à 12 mois, une mesure destinée à inclure davantage de personnes dans le registre national.
Cette initiative s'inscrit dans un contexte où la modernisation des services publics est une priorité pour le gouvernement camerounais. Malgré des efforts récents, le pays reste à la traîne en matière de gouvernance numérique. Selon le Département des affaires économiques et sociales des Nations unies (DAES), le Cameroun se classe 155e sur 193 pays dans l'Indice de développement de l’e-gouvernement (EGDI) 2024, avec un score de 0,4294 sur 1. Cette situation reflète des défis importants liés à l’infrastructure numérique et à la connectivité, que ce projet ambitionne de surmonter.
Au-delà de la simplification administrative, la numérisation de l'état civil devrait avoir des répercussions positives sur le développement socio-économique du Cameroun. La centralisation des données dans un fichier national informatisé et sécurisé renforcera la transparence et la protection des données personnelles, tout en réduisant les risques de falsification ou de perte d'informations.
Samira Njoya
Lire aussi:
Le Cameroun a reçu 18,4 millions $ de la Corée pour réaliser 3 projets numériques
La transformation numérique est devenue un enjeu clé pour moderniser les systèmes de santé à travers le monde, offrant des opportunités inédites pour améliorer les soins. Les collaborations internationales accélèrent cette transition, proposant des solutions innovantes adaptées aux besoins locaux.
Le vice-Premier ministre libyen et ministre de la Santé, Ramadan Abou Janah (photo, à droite), et son homologue russe, Mikhaïl Mourachko (photo, au centre), ont officialisé, lundi 2 décembre, un accord de coopération visant à renforcer les relations bilatérales dans le secteur de la santé. Cette initiative repose sur l’intégration des technologies numériques pour moderniser le système de santé libyen.
Selon un communiqué de l’ambassade de Russie en Libye, l’accord prévoit une coopération accrue entre les deux pays dans l’organisation et la gestion des systèmes de santé, la formation professionnelle de courte durée, ainsi que la mise en œuvre des technologies numériques pour le système de santé. Le texte ajoute que cette collaboration inclut des activités conjointes telles que l’échange d’expertise, de données statistiques et analytiques, l’organisation de conférences médicales, et l’établissement de partenariats entre les organisations médicales, éducatives et scientifiques des deux nations.
Selon les données de la plateforme Statista, la Russie est actuellement le plus grand marché de l'industrie de la santé numérique dans le segment des traitements et soins numériques. Ce secteur connaît une forte dynamique, et les projections estiment que d'ici 2029, le volume du marché devrait atteindre 3706 millions d'euros. Cette expertise place la Russie dans une position idéale pour accompagner la Libye dans sa transformation numérique.
Pour la Libye, l’accord répond à la volonté du gouvernement de relancer son système de santé, gravement affecté par les conflits des dernières années. Grâce aux TIC, le pays espère améliorer l’accès et la qualité des soins. La Russie, pionnière dans l’utilisation de la télémédecine, propose des solutions innovantes qui pourraient être implémentées en Libye afin de fournir des soins à distance de manière efficace. En intégrant les technologies numériques dans son système de santé, la Libye vise à rationaliser la gestion des soins, améliorer la formation du personnel médical et moderniser les infrastructures sanitaires.
Samira Njoya
Edité par Sèna D. B. de Sodji
Lire aussi:
La Russie et l'Ethiopie explorent une collaboration dans l'IA