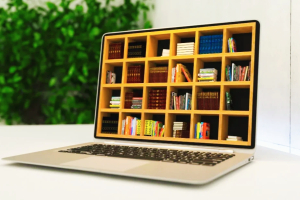La RDC en quête de l’expertise tunisienne pour moderniser son écosystème numérique
En Afrique, les partenariats bilatéraux dans le numérique sont essentiels pour soutenir l’innovation, moderniser les services publics et renforcer l’intégration régionale. Ils représentent une dynamique clé pour accélérer la transformation numérique du continent.
Le ministre congolais des Postes, Télécommunications et Numérique, Augustin Kibassa Maliba, est en visite officielle à Tunis depuis le mardi 22 avril, dans le cadre d’un programme ambitieux visant à renforcer la coopération bilatérale numérique entre la République démocratique du Congo et la Tunisie.
Au programme de son séjour figurent plusieurs rencontres stratégiques : une réunion bilatérale ministérielle au siège du ministère tunisien des Technologies de la communication, une présentation de la plateforme Ecom@Africa et des services postaux, ainsi que des échanges avec la fédération tunisienne des TIC (UTICA) et le Tunisian African Business Council (TABC).
La visite inclut également une immersion dans l’écosystème Smart Tunisian Technoparks (S2T), reconnu pour ses programmes d’accompagnement à l’entrepreneuriat et à l’innovation, ses initiatives en matière de recherche et de formation, ainsi que ses dispositifs d’internationalisation et de mise en réseau des écosystèmes technologiques.
L’un des axes majeurs qui seront abordés concerne le projet de création d’un Technopark à Kinshasa, pour lequel les échanges avec les acteurs tunisiens du numérique pourraient jeter les bases d’une coopération technique renforcée. Cette mission s’inscrit dans une stratégie globale du gouvernement congolais visant à structurer un écosystème numérique efficace, soutenir l’entrepreneuriat technologique local et connecter la RDC aux hubs régionaux d’innovation.
Aujourd’hui, la Tunisie s’affirme comme un acteur technologique majeur en Afrique. Selon le rapport « Measuring Digital Development – Facts and Figures 2024 » publié par l’Union internationale des télécommunications (UIT), 92,8 % de la population tunisienne utilise Internet, un chiffre nettement supérieur à la moyenne mondiale estimée à 70,5 %. Le pays atteint un score de 77,2 sur 100 dans l’indice de développement des TIC (IDI), en constante progression.
Sur le volet de la gouvernance électronique, le rapport des Nations unies « UN E-Government Survey 2024: The Future of Digital Government » classe la Tunisie à la 87e place mondiale (score EGDI : 0,6935), la positionnant 3e en Afrique derrière l’Afrique du Sud (0,8616) et Maurice (0,7506).
Si ces partenariats venaient à se concrétiser, la RDC pourrait tirer profit de l’expérience tunisienne en matière de gouvernance numérique, de modernisation des services postaux, de développement d’écosystèmes technologiques et de soutien à l’innovation entrepreneuriale. Ce partenariat faciliterait le transfert de compétences dans des secteurs stratégiques et accélérerait la numérisation des services postaux. Il favoriserait également la mise en place de projets conjoints, le partage d’expertise sur l’intégration des services publics en ligne et l’amélioration de la connexion de l’écosystème congolais aux réseaux numériques et logistiques africains.
Samira Njoya
Edité par Sèna D. B. de Sodji
Lire aussi:
Identité numérique : la RDC veut s’inspirer du modèle éthiopien « Fayda »
RDC : la société nationale d'électricité choisit Huawei pour numériser ses services .
L'Algérie lance une plateforme de prototypage pour accélérer l'innovation universitaire
Les établissements d’enseignement supérieur en Algérie se modernisent pour mieux répondre aux défis technologiques. Entre équipements de pointe et soutien à la créativité des jeunes, une nouvelle dynamique émerge pour relier formation, recherche et développement économique.
Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari (photo, au centre), a inauguré le mardi 22 avril, au sein de l’université d’Ouzera (wilaya de Médéa), une plateforme de prototypage rapide destinée aux étudiants porteurs de projets innovants. Ce dispositif s’inscrit dans la stratégie nationale visant à faire de l’université un moteur de l’économie de la connaissance.
« L’entrée en service de la plateforme technologique de prototypage rapide vient valoriser les résultats de la recherche scientifique, offre la possibilité aux étudiants de créer des start-up, et renforce le rôle stratégique de l’étudiant dans la création de la richesse et le développement de l’économie du savoir et de l’innovation », a souligné le ministre lors de la cérémonie d’inauguration.
Équipée d’outils de modélisation avancée, de découpe laser et d’impression 3D, la plateforme accélère la conception et la fabrication de prototypes fonctionnels, offrant aux porteurs de projets la possibilité de concrétiser plus rapidement leurs idées tout en réduisant les coûts de fabrication. Elle vient enrichir un écosystème technologique en plein essor au sein des universités algériennes, après le lancement récent d’une plateforme nationale de cloud computing, d’un système de conception et de pilotage de drones, et d’un incubateur universitaire dédié à l’entrepreneuriat et à l’innovation.
Cette initiative s’inscrit dans une dynamique plus large de soutien à l’écosystème entrepreneurial en Algérie. Ces dernières années, l’État a multiplié les dispositifs en faveur des jeunes porteurs de projets à travers la création de structures d’accompagnement comme l’Agence nationale de promotion des incubateurs (ANPI), des centres de développement des start-up dans plusieurs régions, ainsi que des mécanismes de financement tels que le Fonds algérien des start-up, doté de plusieurs milliards de dinars.
À ce jour, l’Algérie recense plusieurs centaines de start-up officiellement enregistrées, actives dans des secteurs clés comme le numérique, la fintech, la santé et l’agriculture intelligente. Le développement de plateformes technologiques dans les universités, à l’image de celle d’Ouzera, vient ainsi renforcer un environnement propice à l’émergence d’une génération d’innovateurs capables de contribuer activement à la diversification économique du pays.
Samira Njoya
Edité par Sèna D. B. de Sodji
Lire aussi:
Cloud, drones, incubateurs : l’Algérie lance trois plateformes pour stimuler l’innovation
Djibouti finalise la numérisation de sa chaîne d’approvisionnement en produits de santé
La modernisation des systèmes de santé par la numérisation devient un levier stratégique essentiel pour de nombreux pays africains. Djibouti, dans sa volonté d'améliorer la gestion des médicaments et des approvisionnements, se tourne également vers de nouvelles technologies.
La Centrale d’achat des médicaments et matériels essentiels (CAMME) de Djibouti a annoncé, le lundi 21 avril, la finalisation de l’installation du logiciel mSupply dans l’ensemble des structures sanitaires du pays. Cette avancée marque une étape clé dans la numérisation du système de santé djiboutien, amorcée depuis 2022 avec l’appui de partenaires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale.
« Grâce à notre système de gestion, les stocks, la traçabilité des médicaments et la planification des approvisionnements sont désormais optimisés, renforçant ainsi l'efficacité, la transparence et la réactivité du système pharmaceutique national », informe la CAMME.
Cette modernisation répond à plusieurs défis stratégiques : éviter les ruptures de stock, minimiser les pertes dues aux péremptions, garantir une distribution efficace des médicaments essentiels et sécuriser le suivi des flux de produits de santé, de la centrale d’achat aux établissements de soins.
Le logiciel mSupply, déjà utilisé dans une trentaine de pays à travers le monde, a prouvé son efficacité, notamment dans des contextes à ressources limitées. Son implémentation à Djibouti s'inscrit dans la mise en œuvre de la Politique pharmaceutique nationale 2023-2027, qui vise à renforcer durablement l’accès aux médicaments essentiels tout en assurant leur qualité, leur traçabilité et leur disponibilité. Cette initiative s’inscrit dans le Projet de renforcement du système de santé, financé par la Banque mondiale et mis en œuvre depuis février 2023. L’objectif est de garantir un meilleur accès aux soins à l’ensemble de la population.
Alors que de nombreux pays africains misent sur la numérisation pour moderniser leurs systèmes de santé, Djibouti affirme son ambition : faire de la technologie un levier stratégique pour améliorer l’efficacité sanitaire et assurer la disponibilité continue des médicaments essentiels.
Samira Njoya
Edité par Sèna D. B. de Sodji
Lire aussi:
Natal Cares mise sur la technologie pour réduire la mortalité maternelle au Nigeria
Transformation numérique : le Sénégal veut renforcer les capacités des fonctionnaires
En février dernier, le Sénégal a officiellement lancé le « New Deal Technologique », sa nouvelle stratégie de transformation numérique pour les années à venir. Le renforcement du capital humain constitue l’un des piliers majeurs de cette feuille de route.
Le gouvernement sénégalais envisage de mettre en place une plateforme e-learning nationale pour la formation continue des fonctionnaires aux compétences numériques. L’exécutif estime que cela permettra d’accélérer et de mener à bien la transformation numérique, pilier du développement socioéconomique du pays dans les prochaines années.
Le développement de cette plateforme est l’un des projets phares discutés lors d’une séance de travail entre le ministère du Numérique et le ministère de la Fonction Publique et de la Réforme du Service public, le vendredi 18 avril. « Cette collaboration renforcée entre nos deux ministères marque une étape clé dans la réalisation du New Deal Technologique et de la vision 2050 du Chef de l'État, dont l’ambition est de bâtir une administration agile, inclusive et centrée sur l’usager – en parfaite synergie avec les priorités de réforme du ministère de la fonction publique », a déclaré le ministère du Numérique dans un communiqué.
Le renforcement des compétences numériques des agents publics constitue l’un des objectifs stratégiques de la politique de transformation numérique. L’exécutif vise à renforcer les compétences de base et intermédiaires afin de développer une conscience numérique et d’instaurer une culture digitale proactive et durable au sein de l’administration. Il prévoit également de moderniser les outils de travail grâce à l’adoption de solutions numériques performantes, d’intégrer l’intelligence artificielle dans les processus administratifs et de mettre en œuvre un dispositif structuré de suivi, d’évaluation et d’amélioration continue des compétences.
Cette approche est validée par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), qui partage cette vision dans ses recommandations. Dans son rapport intitulé « Developing skills for digital government: A review of good practices across OECD governments », elle estime que pour soutenir le passage à l'administration numérique, les pays doivent absolument investir dans le développement des compétences des fonctionnaires. Cela intervient alors que la Banque mondiale estime que près de 230 millions d’emplois en Afrique subsaharienne nécessiteront des compétences numériques d’ici 2030. Aujourd’hui, le Sénégal recense environ 130 000 agents publics.
L’OCDE insiste toutefois sur le fait que la manière dont les opportunités d’apprentissage sont conçues, dispensées et mises en œuvre détermine l’impact qu’elles auront sur les agents. « Dans un premier temps, les gouvernements doivent identifier les compétences numériques et complémentaires requises, puis évaluer dans quelle mesure leurs agents les maîtrisent déjà. Cela permet de repérer les lacunes et d’organiser des formations et des opportunités d’apprentissage pour y remédier, tout en optimisant l’utilisation des ressources disponibles. Ils doivent ensuite évaluer l’impact de ces actions de formation afin d’en tirer des enseignements pour les initiatives futures », recommande donc l’organisation.
Isaac K. Kassouwi
Edité par Sèna D. B. de Sodji
Lire aussi:
Sénégal : plus de 1,7 million $ de TVA récolté en un an grâce aux services numériques
Éducation coranique numérique : le Sénégal initie un partenariat avec Alef Education
Le Mali veut s’inspirer de la Mauritanie en matière de transformation numérique
Depuis les contraintes opérationnelles causées par la pandémie de Covid-19, la transformation numérique s’accélère en Afrique. Après le Bénin en matière de protection des données, le Mali se tourne vers la Mauritanie en vue d’une autre éventuelle coopération sud-sud.
Le ministre mauritanien de la Transformation numérique, Ahmed Salem Ould Bede, a accueilli une délégation officielle du ministère malien de la Communication, de l’Économie numérique et de la Modernisation de l’administration. Cette visite qui s’est déroulée du mardi 15 au jeudi 17 avril, entre dans le cadre d’un échange d’expériences visant à renforcer la coopération entre les deux pays en matière de gouvernance numérique, de régulation des fintech et de numérisation des services publics.
Le programme a comporté des visites techniques au datacenter national, à la salle des serveurs du ministère, ainsi qu’à la direction de la stratégie et de la coopération. Des rencontres ont aussi eu lieu avec des acteurs clés de l’écosystème digital local, tels que la Banque centrale de Mauritanie, le Groupement interbancaire de monétique et des transactions électroniques (GIMTEL), le projet WARDIP, et plusieurs opérateurs spécialisés dans les technologies financières et l’inclusion numérique.
Pour le Mali, cette visite constitue une opportunité de s’inspirer d’un « modèle éprouvé » pour accélérer sa propre transition numérique et améliorer l’efficacité de ses services publics. Elle s’inscrit dans une dynamique plus large de coopération numérique ouest-africaine, où l’échange d’expertises et l’interopérabilité des systèmes publics sont appelés à jouer un rôle central dans la construction d’un avenir numérique intégré, souverain et durable sur le continent. Le Mali s’était déjà tourné vers le Bénin pour le segment protection des données.
Pour rappel, la Mauritanie et le Mali se positionnent respectivement au 21e et au 33e rang à l’indice d’adoption des TIC de l’Union internationale des télécommunications (UIT), avec des scores de 55,5 et 40,4 sur 100. En ce qui concerne l’indice des services en ligne (OSI), l’une des composantes de l’indice de développement de l’administration en ligne (EGDI) des Nations unies, le Mali affiche un score de 0,3334 sur 1 alors que la Mauritanie est en retard sur ce volet avec 0,1688 sur 1.
Cette mission devrait ouvrir la voie à des partenariats institutionnels et techniques entre les deux pays.
Adoni Conrad Quenum
Edité par : Feriol Bewa
Lire aussi:
Protection des données personnelles : le Bénin et le Mali renforcent leur coopération
Le Nigeria et la Gambie envisagent une collaboration dans le numérique
Lors de la 3e édition du Gitex Africa qui s’est déroulé du lundi 14 au mercredi 16 avril au Maroc, le Nigeria et la Gambie ont discuté d’une coopération pour renforcer l’écosystème tech gambien. Le Directeur général de l’Agence nigériane de développement des technologies de l'information (NITDA), Kashifu Inuwa Abdullahia, « a plaidé en faveur de politiques de soutien, telles que des exonérations fiscales pour les startups en Gambie, afin de stimuler l'innovation et les investissements transfrontaliers ».
The DG-NITDA, @KashifuInuwa welcomed the Gambian Minister of Communications and Digital Economy, Hon. Lamin Jabbi, Esq., to the Nigerian Pavilion at GITEX Africa, held in Marrakech, Morocco.
— NITDA Nigeria (@NITDANigeria) April 17, 2025
The meeting focused on exploring collaborative opportunities to revitalise the Gambian… pic.twitter.com/5xn3Z8xwbG
Lire aussi:
Le nigérian Umba lève 5 millions $ pour accélérer sa croissance au Kenya
Identité numérique : la RDC veut s’inspirer du modèle éthiopien « Fayda »
L’identité numérique est devenue un pilier stratégique de la transformation numérique en Afrique. Dans cette dynamique, la République démocratique du Congo (RDC) entend réussir son pari, en s’appuyant sur des partenariats solides et sur l’expérience d’autres pays du continent.
Une délégation de la République démocratique du Congo (RDC), conduite par l’Office national d’identification de la population (ONIP), s’est rendue récemment en Éthiopie pour s’imprégner de l’expérience du pays en matière d’identité numérique. L'initiative avait pour but de tirer parti des enseignements du système éthiopien Fayda, reconnu comme l’un des plus avancés du continent, afin d’alimenter les réflexions sur la création d’un écosystème d’identification numérique fiable et inclusif en RDC.
Delegations from the Democratic Republic of Congo @ONIP_RDC conducted an official visit to Ethiopia to engage in experience-sharing on Ethiopian Digital ID Fayda. The visit aimed at learning from Ethiopia’s progress in implementing a digital and inclusive #Digitalidentity system.… pic.twitter.com/g7ejvOHROV
— Fayda - Ethiopian National ID (@IDethiopia) April 17, 2025
Durant cette visite, la délégation congolaise a eu des échanges approfondis avec les responsables de l’Agence d’identification nationale éthiopienne (ID Ethiopia), portant sur les mécanismes de déploiement du système, les défis rencontrés, ainsi que les innovations mises en œuvre pour garantir une couverture nationale sécurisée.
Le programme a également conduit les représentants de l’ONIP à l’Administration de la sécurité des réseaux d'information (INSA), où ils ont pu découvrir l’architecture de l’infrastructure à clés publiques (PKI), essentielle à la sécurisation des identités numériques et des transactions électroniques. Lors de la visite de l’Institut éthiopien d’intelligence artificielle, la délégation a pu explorer les liens étroits entre l’identité numérique et les technologies de pointe, telles que l’intelligence artificielle.
Cette mission intervient alors que la RDC, pays de plus de 100 millions d’habitants, s’apprête à franchir une étape décisive dans la modernisation de son système d’identification. Un accord a été signé avec la société singapourienne Trident Digital Tech en vue du déploiement d’un système national d’identité numérique conforme aux standards internationaux. Le projet comprend, notamment, la création de 30 000 emplois directs, une augmentation de 40 % de l’inclusion financière, ainsi qu’une réduction notable des délais administratifs.
L’expérience éthiopienne constitue ainsi une source précieuse d’inspiration. Lancé avec l’appui de la Banque mondiale, le programme Fayda vise à enregistrer numériquement au moins 90 millions d’Éthiopiens d’ici à 2030, avec l’ambition de soutenir un large éventail de services publics à travers une stratégie nationale de transformation numérique sur cinq ans.
En s’appuyant sur ces bonnes pratiques africaines, la RDC entend mettre en place une identité numérique fondatrice, levier essentiel pour l’accès aux services de base, la planification des politiques publiques et l’ancrage d’un gouvernement numérique efficace et inclusif.
Samira Njoya
Edité par Sèna D. B. de Sodji
Lire aussi:
La RDC déploie un système national d’identité numérique avec Trident Digital Tech
Le Maroc s’associe à Ericsson pour doter les entrepreneurs de compétences numériques
Les autorités marocaines considèrent le numérique comme un pilier du développement socioéconomique. Cette priorité touche tous les secteurs, y compris l’entrepreneuriat.
Le gouvernement marocain souhaite collaborer avec la société technologique suédoise Ericsson pour doter les entrepreneurs de compétences numériques. Cette vision s’est concrétisée par la signature d’un protocole d’accord en marge de la troisième édition du Gitex Africa, tenue à Marrakech du lundi 14 au mercredi 16 avril.
Les deux parties exploreront diverses pistes afin de permettre aux entrepreneurs et aux petites entreprises marocaines de tirer parti des initiatives éducatives mondiales proposées par Ericsson. Par exemple, la plateforme Ericsson Educate propose une vaste gamme de contenus éducatifs en ligne, abordant des thématiques essentielles comme la 5G, l’intelligence artificielle (IA), le machine learning (ML), l’Internet des objets (IoT), l’automatisation, le cloud computing et les télécommunications.
À terme, le gouvernement marocain aspire à équiper les entrepreneurs des « compétences recherchées pour l'économie numérique croissante du Maroc ». L’initiative pourrait s’intégrer à l’axe 2 de la stratégie de transformation numérique « Maroc Digital 2030 », qui vise à digitaliser le tissu économique pour gagner en productivité. L’exécutif prévoit notamment de poser les bases nécessaires à la digitalisation des entreprises, d’accompagner le passage à l’échelle des PME Tech marocaines et d’aider les très petites et moyennes entreprises dans leur transformation numérique. Grâce à la digitalisation, le gouvernement espère ajouter 100 milliards de dirhams (environ 10,8 milliards $) au PIB national à l’horizon 2030.
Cependant, au-delà des compétences, plusieurs obstacles peuvent freiner les entreprises marocaines dans leur transition numérique. L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pointe des ressources internes limitées, des contraintes financières et un accès restreint à une infrastructure numérique fiable, rapide et abordable. « L'accès à une connexion haut débit rapide, essentiel pour permettre aux entreprises de tirer pleinement parti de la transformation numérique et d'exploiter le potentiel des applications les plus avancées, reste inégal entre les zones urbaines, rurales et isolées », souligne l’organisation.
Il est important de noter que les deux parties n’ont pour l’instant signé qu’un protocole d’accord. Ce document ne constitue pas un engagement ferme, mais une intention de collaborer, dont les modalités concrètes restent à définir lors de discussions futures. La signature d’un partenariat définitif et la mise en œuvre des actions prévues permettront d’évaluer concrètement les perspectives et l’impact de cette collaboration.
Isaac K. Kassouwi
Edité par Sèna D. B. de Sodji
Lire aussi:
Le Maroc s’engage dans la numérisation des services de la Bibliothèque nationale
Le Maroc s’engage dans la numérisation des services de la Bibliothèque nationale
Le Maroc a entrepris depuis quelques années la numérisation de son patrimoine documentaire. Le projet devrait connaître des avancées majeures dans les mois à venir, avec l’objectif de préserver les archives nationales et de faciliter leur accès à tous.
Le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, le ministère de l’Économie et des Finances, le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, ainsi que la Bibliothèque nationale du Maroc ont signé, mercredi 16 avril à Marrakech, une convention de partenariat. L'accord, intervenu en marge de la 3ᵉ édition du salon technologique Gitex Africa, a pour objectif la numérisation du fonds documentaire de la Bibliothèque nationale.
Signature d'une convention pour numériser le fonds de la Bibliothèque Nationale du Maroc. Objectif : rendre la culture plus accessible et inclusive grâce au numérique.https://t.co/x5TwNlMTvV #MarocDigital2030 #CultureNumérique pic.twitter.com/Kg0j9DnMgL
— La Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc (@Bnrm_officiel) April 16, 2025
La convention prévoit la numérisation des manuscrits anciens, des périodiques et des collections léguées conservés par la Bibliothèque nationale. Celle-ci conserve aujourd’hui un vaste patrimoine documentaire, constitué d’environ 700 000 livres et objets d'art, ainsi que de plus de 100 000 manuscrits. La convention comprend également la refonte du portail institutionnel, l’introduction du dépôt légal pour les ouvrages numériques, ainsi que l’intégration de la langue amazighe dans les services numériques proposés. Un programme informatique dédié aux personnes à besoins spécifiques sera également mis en place.
Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la stratégie Maroc Digital 2030 qui vise à accélérer la transformation numérique du pays, notamment à travers la modernisation des services publics. La Bibliothèque nationale, en tant que gardienne du patrimoine écrit et centre de rayonnement culturel, occupe une place centrale dans ce dispositif. Ce projet répond aussi aux orientations du roi Mohammed VI, qui appelle à faire du numérique un levier de développement humain, de savoir et d’inclusion sociale. Il vient compléter les chantiers de dématérialisation déjà engagés dans l’administration, la justice, l’éducation ou encore la santé.
Au-delà de l’aspect technique, les enjeux sont multiples : préserver durablement les œuvres littéraires et historiques du royaume contre les risques de dégradation ou de disparition, élargir l’accès aux ressources documentaires à tous les citoyens, y compris ceux vivant dans des zones éloignées, et offrir aux chercheurs des outils modernes de consultation. Ce projet vise également à accroître la visibilité internationale du patrimoine culturel marocain, en rendant ses trésors documentaires accessibles sur le web, dans une démarche de partage et de transmission des savoirs.
Samira Njoya
Lire aussi:
La RDC sollicite l’aide de la France pour numériser sa bibliothèque nationale
Sénégal : plus de 1,7 million $ de TVA récolté en un an grâce aux services numériques
À l’heure où l’économie numérique prend une place croissante dans les échanges mondiaux, les États africains s’efforcent de mieux encadrer les flux digitaux. Le Sénégal mise sur la fiscalité numérique comme levier de souveraineté et de mobilisation de ressources à l’ère des géants du web.
L’introduction de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) appliquée aux services numériques commence à produire des résultats concrets au Sénégal. Jean Koné, directeur général des Impôts et des Domaines (DGID), a annoncé que l’État a collecté plus d’un milliard de francs CFA, soit plus de 1,7 million de dollars en 2024 grâce à cette mesure. Cette déclaration a été faite le mardi 15 avril, lors de la conférence internationale sur la taxation de l’économie numérique en Afrique qui se tient à Dakar.
Encouragée par ces premiers résultats, l’administration fiscale entend intensifier ses efforts pour mobiliser encore plus de ressources dans les années à venir. « Nous allons déployer des stratégies et innover pour que chacun s’acquitte de la TVA numérique. Il est aussi question d’adapter notre système pour qu’il soit plus inclusif et efficace », a déclaré Jean Koné. À moyen terme, le gouvernement vise des recettes comprises entre 3 et 5 milliards FCFA, avec des perspectives allant jusqu’à 10 milliards.
Mise en place le 1er juillet 2024, cette taxe concerne les services proposés par des entreprises nationales ainsi que par des plateformes numériques étrangères actives au Sénégal. Contrairement à une imposition forfaitaire, la base imposable est calculée à partir du chiffre d’affaires réel des fournisseurs non-résidents, en fonction des contreparties reçues ou à recevoir. Cela permet de refléter plus fidèlement les revenus générés sur le marché sénégalais.
Le taux standard de la TVA au Sénégal est fixé à 18 %, avec une réduction spécifique de 10 % pour les secteurs en difficulté comme l’hôtellerie et la restauration, touchés par la pandémie de Covid-19. Sont notamment concernés par cette fiscalité les services de streaming, les abonnements logiciels (SaaS), le cloud computing, la publicité en ligne, les jeux téléchargeables et les applications mobiles payantes.
Si la mesure renforce les recettes de l’État, elle n’est pas sans conséquences pour les usagers. En taxant les plateformes sur la base de leurs revenus réels, les prix de certains services numériques pourraient augmenter, risquant d’exclure les populations les plus vulnérables. Le véritable défi pour les autorités sera donc de concilier efficacité fiscale et accessibilité numérique, afin que la transformation numérique ne se fasse pas au détriment de l’inclusion.
Samira Njoya
Edité par Sèna D. B. de Sodji
Lire aussi:
Le Sénégal introduit une taxe sur les services numériques le 1er juillet